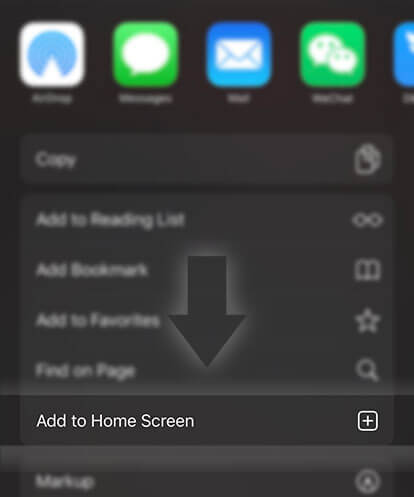《Littérature et pop culture》Lire Dororo (Osamu Tezuka, 1967-68) en édition Prestige (Delcourt, 2021)
Advertisement
Le 3 Février 2021, dans la foulée des rééditions lancées en 2018 par Delcourt/Tonkam pour les 90 ans de la naissance de l'auteur, paraissait le premier volume de l'édition prestige de Dororo (Osamu Tezuka, 1967-68). La quête de Hyakkimaru, à la recherche des 48 parties du corps qui lui ont été volées par des démons à la naissance, et de Dororo, l'orphelin qui l'accompagne, était déjà publiée en quatre volumes chez Delcourt depuis 2006. Si elle ne présentait pas une œuvre inédite, la nouvelle édition avait l'avantage d'être collector : un bel ouvrage au format A5, au papier épais et à la couverture cartonnée, comblant majestueusement le manque d'une édition récente. Un acheteur s'en est saisi en librairie avec enthousiasme. Pourtant, après ça, l'ouvrage est resté prendre la poussière pendant plusieurs mois sur une pile de livres non lus, passant derrière d'autres ouvrages obtenus entre-temps. Comment expliquer ce revirement ? Pourquoi une œuvre, d'abord achetée avec plaisir, est devenue progressivement une charge de lecture que l'on remet à plus tard ? Nous ferons l'hypothèse que cela tient d'un décalage une intention de lecture plaisir, à l'attention esthétique faible, et l'édition elle-même, qui construit du white cube incitant à une attention esthétique forte.
Dans quelle mesure l'édition prestige de Dororo met-elle en tension deux modes de lecture, et à quelle type de public s'adresse-t-elle finalement ?
Dans un premier temps, nous montrerons comment l'édition prestige crée du white cube, en invitant à une relation dépragmatisée et à une valorisation de l'auteur comme avant-gardiste. Puis nous étudierons la position, opposée, d'une lecture légère et d'une appropriation subjective. Enfin, nous analyserons la difficulté à classer Dororo comme objet de haute-culture, pop ou sous-culturel, et nous interrogerons le « bon goût pop » mis en scène par cette édition.
Comme l'a montré Emmanuel Souchier dans ses divers travaux, un texte ne paraît jamais de manière neutre au lecteur, car il est façonné par une énonciation éditoriale à tous les niveaux : de la forme du livre au paratexte et au texte lui-même. Dans le cas de Dororo, l'édition prestige revendique son travail formel, et veut persuader le lecteur qu'il a affaire à un « bel objet ».
Le dossier est introduit comme « un florilège des plus belles ouvertures de chapitres parues dans des magazines de prépublication, ainsi que des pages couleur de publicité pour l'animé, suivi de couvertures du Weekly Shônen Sunday. » C'est le seul moment, dans l'ensemble de l'édition, où le contexte de publication original du manga (paru en feuilleton durant un an, aux-côtés de 13 autres séries, dans le Weeky Shônen Sunday) est mentionné ; mais le superlatif « des plus belles » et le nom « florilège » impliquent un registre est poétique. C'est le même procédé que lorsque, dans Le paysan de Paris (1926), Louis Aragon met en scène une errance dans les rues de Paris et reproduit, dans le texte poétique même, des publicités. Ces énoncés perdent toute visée informationnelle en étant lus dans un recueil de poésie, et deviennent poétiques. Ainsi, comme l'explique Jean-Marie Schaeffer dans Adieu à l'esthétique (2000), un objet est « artistique » lorsqu'on a envers lui une relation dépragmatisée, c'est-à-dire une relation qui n'est pas guidée par un intérêt direct. En réalité, les publicités pour l'anime et les couvertures de chapitre de Dororo ont une visée pragmatique : celle d'inviter à lire ou à regarder la série. Or, pour en faire des objets d'art, il suffit de les extraire de leur contexte d'origine et de privilégier une relation dépragmatisée : elles sont alors valorisées pour leur beauté. Par ailleurs, l'édition prestige a une couverture plus élaborée que la première édition du manga chez Tezuka : si la première avait, sur sa couverture, uniquement un personnage détouré sur fond de couleur uni, la nouvelle couverture comporte un arrière-plan blanc et bleu, les personnages étant centrés et encrés en gris foncé. Cette mise en page est en harmonie avec les autres couvertures de la « collection Tezuka » : Ayako (1972-73), L'histoire des 3 Adolf (1983-85), La vie de Bouddha (1983-84) ; parmi d'autres séries de l'auteur, sont publiées dans cette « collection prestigieuse » lancée en 2018, et dont les couvertures comportent généralement un fond coloré, une image bicolore qui contraste avec celui-ci ; un titre inscrit en grand dans le bas de la page, avec « Osamu Tezuka » au-dessus et un bandeau « Intégrale » en-dessous.
Advertisement
Tous ces procédés créent du white cube sur Dororo. Dans son étude White cube, l'espace de la galerie et son idéologie (2008), Brian O'Doherty montre que les musées se sont transformés pour redonner aux œuvres d'art leur « aura ». En effet, comme l'avait expliqué Walter Benjamin dans L'Œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique (1935), la capacité de production en masse d'objets culturels a fait perdre aux œuvres leur unicité, et donc leur dimension sacrée. Pour Brian O'Doherty, avoir construit un « cube blanc » dans les musées, en espaçant les œuvres d'art et en les affichant sur des murs les plus neutres possible, a été un moyen de rendre à l'art cette dimension sacrée. Il s'agissait de séparer les expériences esthétiques quotidiennes (télévision, livres de poche, publicité, presse et ambiances) de « vraies » expériences esthétiques, au sens où elles étaient complètement dépragmatisées (on observe les œuvres d'art d'un musée pour elles-mêmes, pas pour savoir si elles décoreraient bien notre appartement). Minimiser les sollicitations esthétiques en-dehors de l'œuvre elle-même, c'est aussi ce que fait Gallimard avec la collection blanche, dans laquelle sont publiées toutes les nouvelles sorties en littérature générale : une collection standardisée, où la police et la couleur du titre restent les mêmes, sur un fond blanc crème, afin que l'originalité du texte soit saisie en elle-même ; en-dehors des séductions que pourraient être la couverture ou le paratexte. Si elle n'est pas « blanche » (parce qu'il s'agit d'un objet de bande-dessinée, qui passe donc nécessairement par l'image) ; la collection Tezuka construit tout de même du white cube, en affichant une neutralité et une qualité apparente qui font de Dororo un objet d'art.
Le white cube n'est pas qu'une question de forme : il exige aussi, dans une perspective moderniste, de valoriser l'auteur comme artiste, et le mettre sur un piédestal. C'est ainsi que les auteurs de la Nouvelle Vague, par exemple, ont défini le cercle d'un cinéma artistique en s'appuyant sur la figure centrale du réalisateur, tenu pour seul garant de la qualité et de l'auctorialité d'un film. De la même manière, l'édition prestige de Dororo s'appuie largement sur son auteur, notamment avec une préface qui doit être commune à tous les livres de la collection. Sur le bandeau de la jaquette, on peut lire une courte biographie de Tezuka, redoublée ensuite par la préface de trois pages écrite par Patrick Honnoré (responsable de la traduction de l'ouvrage). Sur le second bandeau de la jaquette, on peut lire la liste des autres volumes, parus ou prévus, de la collection Tezuka. La préface rappelle, par tous les moyens possibles, qu'Osamu Tezuka est le « Dieu du manga ». L'accroche est dans le registre de l'exploit : « Quelques chiffres suffisent à mesurer l'immensité d'Osamu Tezuka (1928-1989) : 170 000 planches de bande-dessinée (si vous aimez faire parler les chiffres, cela fait plus de 7,5 planches par jour, de sa naissance à sa mort), 700 titres... ». Après les chiffres qui font de lui un surhomme, c'est son statut de fondateur qui est mis en avant : « Fondateur du manga moderne, il demeure une référence incontournable pour les auteurs qui lui ont succédé ». En plus d'être le créateur de deux industries « celle du manga (papier) et celle du dessin animé de diffusion hebdomadaire », Tezuka est considéré comme celui qui a révolutionné la grammaire du manga, en en faisant un « moyen d'expression total ». La préface dans son ensemble est hyperbolique, et n'hésite pas à diviniser le personnage : « Son titre de 'dieu du manga' est peut-être à prendre au premier degré » ; « Son décès, un mois jour pour jour après celui de l'empereur Shôwa [...], autrement dit au moment où le Japon, littéralement, changeait d'ère, parachève son accession au niveau symbolique du réel. »
Advertisement
L'œuvre de Tezuka dans son ensemble est alors considérée comme excellente : « Il y a une autre façon de 'mesurer' Tezuka. Le lire. Chaque fois que je relis Ayako, j'aboutis à la même conclusion : chef-d'œuvre absolu ». La proposition « Le lire. », isolée, donne une forme de gravité qui n'appelle pas à discussion du jugement sur l'œuvre, de même que le superlatif « chef-d'œuvre absolu ». Le préfacier rapporte des débats sur le « sommet » du style graphique de Tezuka, et valorise son travail, de dessin comme de mise en scène, à toutes les échelles : « Rentrer dans chaque page, chaque case, chaque bulle ». Si la réception est évoquée, c'est pour rappeler à quel point Tezuka, comme un poète romantique, est au-dessus de notre humanité de lecteur : « Ses chef-d'œuvre procurent un sentiment de grandeur, celui que l'on est au sommet d'une montagne : un homme est monté là-haut et en est revenu avec une révélation hors de portée du commun des mortels. Il devait savoir voler. » Nous pouvons commenter deux éléments de justification apportés par le préfacier : le rapport à l'Occident, et la maturité de son œuvre. Pour le premier, il est un passage obligé lorsqu'on introduit un auteur oriental sur nos terres : il faut rappeler aux lecteurs français que Tezuka partage les mêmes références qu'eux. Dès le bandeau bibliographique de la jaquette, on rappelle son admiration pour « les dessins animés de Walt Disney et des frères Fleischer ». Mais, si la référence à Disney est inévitable, on enchaîne immédiatement sur le cinéma des Frères Fleischer, moins connu et plus adulte, pour désamorcer l'image d'industrie populaire qui colle à Disney, et, par extension, à Tezuka. Plus tard, le préfacier insiste : « Mais à la différence du modèle Walt Disney bâti sur un concept classique de 'marque', avec un style graphique peu évolutif et un cahier des charges [...] normé et balisé, la postérité de l'œuvre de Tezuka se construit sur le modèle de 'mèmes' ». D'une certaine manière, l'admiration réelle de Tezuka pour Walt Disney, aussi bien d'un point de vue industriel qu'artistique et thématique ; est minimisée dans l'édition prestige, autant par anti-américanisme que par la volonté affirmée de le placer du côté des « auteurs ». Le second élément est lui aussi un passage obligé : pour « légitimer » un corpus de bande-dessinée, il faut encore une fois réserver qu'il n'est pas destiné aux enfants. Il s'agit ici de remarquer un virement dans le ton des histoires de Tezuka : « A partir du milieu des années 60, Tezuka densifie encore ses histoires et n'hésite pas à aborder des sujets plus sombres ». Ainsi, la collection Tezuka a un choix de titre assez restreint, qui préfère aux œuvres les plus populaires des œuvres évoquant la misère, les maltraitances sexuelles, la seconde guerre mondiale (Ayako, 1972-73 ; Barbara, 1973-74 ; MW, 1976-78 ; L'Histoire des 3 Adolf, 1983-85), ou encore un récit spirituel et historique (La vie de Bouddha, 1974). La série la plus célèbre de Tezuka, fondatrice de l'industrie anime par son adaptation, Astro, le petit robot (Tetsuwan Atomu, 1952-68), n'est mentionnée dans la préface que de manière détournée, en évoquant la série Pluto de Naoki Urasawa (2003-2009, basée sur l'univers d'Astro). Il en va de même pour Le Roi Léo (1950-54). Enfin, faire de Tezuka une figure d'avant-garde, c'est dire que personne n'a jamais fait, ni ne fera jamais, de manga comme lui : « Sans doute le manga contemporain a gagné en légèreté, mais pour ce qui est de l'expression de la complexité, en revanche, je crois que c'est quelque chose qui est perdu. » Tezuka est alors considéré comme le seul représentant d'un style, personnage d'une époque entière, de la même manière que Victor Hugo emblématise le romantisme, et avec lui, tout un pan de l'histoire littéraire du XIXe siècle. On en revient à une histoire littéraire par monographies, comme elle s'est constituée sous la Troisième République avec la fixation du canon. En excluant le contexte de production (omniprésence de la presse au XIXe siècle, magazine de prépublication et industrie du manga pour Tezuka), on laisse entendre que ces œuvres ont un génie intrinsèque.
L'édition Prestige de Dororo projette un plaisir de lecture moderniste. Notons d'abord qu'elle vise des classes sociales culturellement élevées. On s'en rend compte par le renvoi à des notions ou des auteurs dans la préface : le « montage parallèle du cinéma » y est présenté comme un appui pour la mise en scène des œuvres de Tezuka, sans que le terme technique ne soit explicité. De même avec la précision, entre parenthèses « (du cinéma d'Eisenstein en particulier, comme l'a montré Ôtsuka Eiji) ». Le renvoi à un théoricien du manga rappelle le mode d'écriture de la recherche. Par ailleurs, c'est le cinéma d'Eisenstein, reconnu dans les monographies de cinéma comme fondateur en terme de montage, qui est cité : il s'agit d'une référence institutionalisée et qu'on suppose connue du lecteur.
La préface construit ensuite une analyse : de l'œuvre de Tezuka, d'abord, que l'on divise en périodes (une positive, puis une seconde plus pessimiste) ; puis de sa grammaire de récit, valorisée pour sa complexité. Dans une perspective de lecture moderniste, qui prédomine encore à l'université, la bonne lecture va contre le sens original du texte. Le but de l'analyse doit être, derrière l'apparence, de comprendre un « sens caché » voulu par l'auteur. Ces critères devenus prescriptifs, ce sont les textes les plus complexes, les moins évidents à comprendre, qui ont été considérés comme les meilleurs d'un point de vue littéraire. Certains auteurs ont joué de cette position : Vladimir Nabokov, par exemple, exige un lecteur « relecteur », capable de saisir les sous-entendus et les codes, mais aussi de comprendre le sens de l'histoire derrière sa complexité apparente. Dans le cas de Tezuka, le préfacier affirme qu'il voulait également pousser ses lecteurs au décodage :
« Avec une grammaire capable d'exprimer le plus subtil, les personnages monolithiques et les narrations simplistes n'ont plus de raison d'être, et le lecteur, qui a intégré ce langage en même temps qu'il se mettait en place, le décode spontanément. 'Le lecteur ne comprendrait pas', lieu commun des éditeurs qui préfèrent infantiliser les lecteurs, ne se justifie jamais avec Tezuka. »
La préface mentionne le plaisir du lecteur ; il est même omniprésent au sens où elle est rédigée à la première personne. Mais il ne s'agit pas d'une lecture intime ou subjective : le plaisir du lecteur tient, dans cette perspective moderniste, de l'analyse uniquement. De la même manière que le secondaire puis l'université nous apprennent à décoder un texte pour, en en montrant la fabrication ; prouver qu'il est réussi ; le plaisir de Patrick Honnoré est ici justifié par des qualités inhérentes à l'œuvre :
« A partir de Princesse Saphir, la mise en œuvre des temporalités complexes, enchâssées, des points de vue subjectifs, fluctuants [...], les émotions les plus inconscientes pour les personnages eux-mêmes, (l'une de mes plus grosses émotions de lecteur : me rendre compte que Barbara elle-même ne sait pas si elle est amoureuse de Mikura), [...] deviennent des outils disponibles entre les mains de l'auteur pour [...] construire un espace infini de significations pas toutes explicites. »
L'émotion du lecteur, si elle est réhabilitée ici, se base sur un élément de complexité interne, un « déchiffrement » valorisé par les modernistes. Surtout, elle passe au second plan, puisqu'elle est inscrite entre parenthèses, et insérée à une énumération de ce que Tezuka a ajouté à la grammaire du manga. Ici, Patrick Honnoré rejoint le processus décrit par Kant dans son analyse du « jugement de goût », le « libre jeu de l'entendement et de l'imagination » (Critique de la faculté de juger, 1790). D'après son analyse, formuler un jugement nécessite de transformer l'indicible d'une expérience subjective (notre approche esthétique d'un objet ne peut être qu'unique, car elle dépend d'un grand nombre de facteurs contextuels et individuels), en des critères « objectifs » de beauté ou de qualité, que l'on veut partagés par la communauté. Formuler un jugement de goût c'est alors traduire notre ressenti en un message capable d'être compris par le plus grand nombre : dire « C'est beau » (et non « Ça me plaît ») nécessite de se justifier. Dans le cas de l'analyse moderniste, on justifie la beauté en décortiquant des procédés formels, et en les mettant en relation avec l'histoire du medium (c'est dire, par exemple, comment la modernité rimbaldienne a bouleversé un grand nombre de codes de la poésie). Dans cette petite affirmation du préfacier, on trouve le passage d'un sentiment personnel, « l'une de mes plus grosses émotions de lecteur » ; à un jugement objectif, mettant en relation la grammaire de Tezuka avec celle des autres auteurs contemporains.
Advertisement
- In Serial6 Chapters

Never heard of that god? Well, wanna convert?
I died and reincarnated like any other good little protagonist, let's just hope I don't have their troubles. What do you mean I'm your god? No, no, no that sounds too troublesome. Go worship someone else. Hey, what are you guys doing down there? What! Promoting my religion?! No, no, no. No thanks. Don't expect too much of me! and constructive criticism is always good!
8 271 - In Serial25 Chapters

The Orphan and the Thief
From the very beginning it was all Toad’s fault. A blundering, quick-talking thief, he was the one who cut a deal with the dangerous Edward P. Owl: track down the ingredients to the Seeking Solution, or else. Twenty-five thousand gorents, he’d said to her. That was all it took for Melena, a lonely orphan with a knack for potions, to pack her bags and join in on the quest. From the majestic forest of Holly-Harp Wood to the labyrinth caves of Dunthur to the frigid waters of the Blackens, they search for Owl’s ingredients. Toad and Melena must face sea dragons, cave monsters, birds as large as wagons, kidnappers, and thieves. Toad’s in it to save his head – cross Owl and start digging your own grave. Melena’s in it to get paid so she can start a new life, one that includes her missing brother. But you really can’t trust thieves. The Orphan and the Thief is also available on Kindle and in paperback via Amazon.com. Thanks for reading!
8 204 - In Serial13 Chapters

THE TIME MACHINE (Completed)
The Time Machine is a science fiction novel by H. G. Wells, published in 1895 and written as a frame narrative. Wells is generally credited with the popularization of the concept of time travel by using a vehicle that allows an operator to travel purposely and selectively forwards or backward in time. The term "time machine", coined by Wells, is now almost universally used to refer to such a vehicle. The Time Machine has been adapted into three feature films of the same name, as well as two television versions, and a large number of comic book adaptations. It has also indirectly inspired many more works of fiction in many media productions.
8 179 - In Serial7 Chapters

♡ LEMON JUICE ♡ T B H K
𝐑𝐞𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭 𝐚𝐫𝐞 𝐨𝐩𝐞𝐧~𝐗 𝐅𝐞𝐦𝐚𝐥𝐞! 𝐫𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫 ♡𝐚𝐧𝐝 𝐗 𝐌𝐚𝐥𝐞! 𝐫𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫 ♡𝐈𝐭 𝐜𝐚𝐧 𝐨𝐧𝐥𝐲 𝐛𝐞 [🍋- 𝐋𝐄𝐌𝐎𝐍][🍊- 𝐋𝐈𝐌𝐄]𝐋𝐚𝐭𝐞 𝐧𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐥𝐞𝐦𝐨𝐧/𝐥𝐢𝐦𝐞 𝐨𝐧𝐞𝐬𝐡𝐨𝐭𝐬~♥I don't own toilet bound hanako kun!
8 155 - In Serial32 Chapters

Two Wastes of Space- J.C
THE ORIGINAL WAS ON MY OTHER ACCOUNT @moonsf1tch so dw I'm not stealing :)UNDER EXTENSIVE EDITING TOO
8 102 - In Serial37 Chapters

Hood shit 3
Book 3 of hood shit .. enjoy because this have been wanted for the longest💕( definitely hate this book but enjoy ig)
8 200







 Prev Chap
Prev Chap Next Chap
Next Chap Chap List
Chap List
 Boy
Boy Girl
Girl